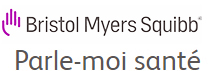Rétrospective des dernières lois de financement de la sécurité sociale (2017-2022)
Prix des médicaments
En France, les médicaments remboursables sont régulés : les prix sont fixés par convention entre le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) et l’industriel. Cette négociation et les dépenses consenties pour le médicament sont soumises à un cadre strict de règles.
Les prix fabricants hors taxes (PFHT) sont fixés par convention entre le laboratoire et le CEPS, représentant l’Etat, et, à défaut, de manière unilatérale par le CEPS. Les prix sont donc régulés pour les médicaments remboursables de ville, les médicaments de la liste en sus et les médicaments rétrocédables. Les médicaments régulés représentent, en 2020, 86 % du chiffre d’affaires en France de l’industrie du médicament, selon le LEEM.
Prix et remboursement
Pour faire l’objet d’un remboursement par la Sécurité sociale, un médicament doit remplir un certain nombre de conditions – dont avoir fait l’objet d’une demande d’inscription sur l’une des listes de remboursement des spécialités pharmaceutiques. En effet, en fonction du circuit de distribution, à la ville ou à l’hôpital, plusieurs listes de remboursement existent.

« Liste en sus » : Parallèlement à la mise en place de la tarification à l’activité (T2A), un dispositif dérogatoire a été prévu pour la prise en charge des médicaments innovants les plus onéreux. Instituée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004, la « liste en sus » permet aux établissements de santé de facturer à l’Assurance maladie certaines spécialités pharmaceutiques, en sus des tarifs des GHS, et d’obtenir leur remboursement à 100%. Les tarifs de responsabilité de ces spécialités pharmaceutiques sont fixés par le Comité économique des produits de santé et publiés au Journal Officiel sous la forme d’avis de prix.
« Rétrocession » : Les médicaments inscrits sur cette liste présentent notamment des contraintes particulières de distribution, de dispensation ou d’administration qui nécessitent un suivi de la prescription ou de la délivrance. Les conditions de prise en charge de ces médicaments sont précisées par :
Un arrêté de prise en charge au titre de la rétrocession cosigné par la DSS et la DGS
Un avis de prix de cession du CEPS
Un taux de prise en charge arrêté par l’Union nationale des caisses d’Assurance maladie.
A l’hôpital
Il convient de noter que les médicaments vendus aux hôpitaux sont soumis à une réglementation prévue par le Code de la santé publique (agrément aux collectivités). Depuis 1987, leurs prix sont libres et les achats par les établissements publics de santé sont régis par le Code des marchés publics.
Toutefois, la mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A) et l’organisation de la rétrocession dans les établissements de soins limitent cette liberté de prix pour les produits dits « innovants et coûteux », non pris en charge par la T2A (« liste en sus »), et pour les produits rétrocédables.
En ville
Les médicaments vendus et dispensés en ville sont également soumis à une réglementation prévue par le Code de la santé publique (liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux) ainsi que par des dispositions du Code de la Sécurité sociale. Leurs prix sont administrés par le CEPS après une négociation entre le CEPS et le laboratoire pharmaceutique.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le module sur Les mécanismes de tarification et de régulation des prix par le CEPS.
Tranches de remboursement
Le taux de remboursement d’un médicament est conditionné par son service médical rendu (SMR), apprécié par la Commission de Transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS). Il existe plusieurs taux de remboursement, en fonction des caractéristiques du médicament.
Les médicaments dont le service médical rendu est considéré comme insuffisant ne sont pas remboursables.
En cas d’affection grave de longue durée (ALD), inscrite sur une liste officielle de vingt-neuf maladies, les traitements destinés à soigner cette maladie sont pris en charge à 100 % s’ils sont remboursables quel que soit leur taux de remboursement.


Une asymétrie de prise en charge entre la ville et l’hôpital
Le dispositif de la liste en sus permet aux établissements de santé de facturer à l’Assurance maladie certaines spécialités pharmaceutiques en sus des GHS et d’obtenir leur remboursement à 100%. Ce mode de financement est essentiel à la diffusion des traitements innovants à l’hôpital qui, sans cela, ne seraient pas prescrits dès lors que leur coût est trop élevé pour être intégré dans le forfait de GHS ou pris en charge sur les fonds propres de l’établissement.
Ce dispositif implique néanmoins une asymétrie d’accès des médicaments entre la ville et l’hôpital, notamment si le SMR du médicament n’est pas majeur ou important. En effet, à l’hôpital, seul ce niveau de SMR permettra l’inscription d’un médicament onéreux sur la liste en sus, et donc de le rendre accessible pour les patients à l’hôpital. En ville, le niveau de SMR n’a pas d’impact sur l’accès. Ainsi, les médicaments ayant obtenu un SMR modéré voire faible peuvent tout de même être mis à disposition des patients, seul le taux de remboursement par l’Assurance maladie varie (30 % et 15 % respectivement, voire 100% si la pathologie est une ALD).
Parmi les sujets relatifs au prix du médicament au cours des 5 dernières années, deux thématiques principales ont été abordées dans le cadre des lois de financement de la Sécurité sociale :
-Les associations de médicaments
-La prise en compte de l’empreinte industrielle
L’innovation & les associations de médicaments
Les défis liés aux innovations, notamment financiers, ne sont pas limités au seul développement quantitatif des innovations médicamenteuses. Les modes de prises en charge ainsi que les stratégies thérapeutiques recourant à de nouvelles molécules se diversifient, faisant intervenir par exemple des associations de thérapies ciblées ou une utilisation séquentielle de ces thérapies dans le cancer.
Les pouvoirs publics se sont très tôt emparés de ce sujet. En effet, les orientations ministérielles du 17 août 2016 ont marqué un tournant en assignant au CEPS des objectifs plus volontaristes et des principes plus rigoureux dans la fixation du prix des médicaments. Il était ainsi demandé au Comité de faire émerger des mécanismes de régulation conventionnelle ambitieux, fondés sur la régulation d’une pathologie et non d’une seule spécialité. Il était annoncé que l’utilisation de produits en association de traitement devait dans tous les cas conduire à revoir le prix de ces traitements afin que le coût net de l’association n’excède celui de chaque molécule qu’à raison d’un bénéfice thérapeutique démontré.
La prise en compte de l’empreinte industrielle
La France et l’Europe ont eu à gérer, ces dernières années, des situations de tensions voire de ruptures d’approvisionnement de principes actifs pharmaceutiques (API) et de médicaments (voir module « Prévention des pénuries de médicaments »). La crise de la Covid-19 a mis en exergue les vulnérabilités de certaines chaînes d’approvisionnement des matières premières et notre dépendance sanitaire aux pays hors Union Européenne, et la nécessité, pour la France et l’Europe, de gagner en indépendance industrielle et sanitaire pour l’approvisionnement en médicaments.
L’accord-cadre, signé entre le LEEM et le CEPS en mars 2021, a pris en compte cette problématique par l’ajout d’un chapitre spécifique dédié au soutien des investissements et à l’exportation (chapitre 3). Ainsi, un produit peut bénéficier d’une stabilité de son prix fabricant hors taxes (PFHT) pendant 5 ans maximum en fonction des investissements en lien direct avec ce même produit en termes de production, R&D ou solutions numériques qui ont été réalisés ou en devenir en UE, notamment en France (article 27). A noter que la durée de stabilité liée aux investissements peut être cumulée avec les autres mesures conventionnelles sur une durée maximale de 6 ans.
Des avoirs sur remises pour investissements au titre du guichet du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) peuvent également être attribués pour une durée de 1 an ou plus lorsque les investissements des laboratoires visent à développer les produits, ou bien encore à augmenter, optimiser ou digitaliser les capacités de production.
De plus, dans ce contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, le Gouvernement a souhaité renforcer la prise en compte de l’empreinte industrielle dans la fixation des prix des produits de santé, de façon à inciter à l’augmentation des capacités de production en vue de l’approvisionnement du marché national. La LFSS pour 2022 a donc introduit un nouvel élément pouvant entrer en compte dans la fixation du prix des médicaments par le CEPS, à savoir la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production (article L. 162-16-4 du CSS).

Une volonté exposée durant le CSIS du 29 juin 2021
Le CSIS, qui s’est tenu le 29 juin 2021 autour du président de la République, a traduit l’ambition de l’État de faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé d’ici 2030. Le président a notamment exprimé le souhait de renforcer la prise en compte de l’empreinte industrielle dans la fixation du prix du médicament et des investissements sur le territoire avec un doublement des crédits CSIS médicaments, et l’élargissement aux dispositifs médicaux. En 2019, le total des avoirs CSIS accordés était de 50 M€ selon rapport d’activité du CEPS 2019.
Vue d'ensemble des articles au cours des 5 dernières années

Focus sur les articles d’intérêt
Hôpital
Article 56 (LFSS pour 2018)
La mesure clarifie les conditions dans lesquelles est opérée la tarification des médicaments biosimilaires, génériques et des médicaments qui sont comparables à l’hôpital, en ouvrant la possibilité d’un « tarif de remboursement unifié ». Cette disposition doit permettre d’éviter de créer des conditions de prise en charge différentes entre des médicaments à l’efficacité identique. Dans le cas d’un tarif unifié, la base de remboursement par l’Assurance maladie devient la même pour les différents médicaments, et l’incitation pour les hôpitaux à acheter le médicament don’t le tarif de remboursement est le plus élevé, est neutralisée.
Cette mesure introduit également un prix limite de vente des entreprises aux établissements de santé des produits figurant sur la liste en sus ou dispensés par rétrocession ; ce prix sera négocié entre le laboratoire et le CEPS selon les conditions usuelles. Ce prix limite de vente permet de protéger les hôpitaux contre un « reste à charge » qui s’imposeraient à eux dans le cas où les fabricants décideraient de vendre leurs médicaments à un prix plus élevé que la base de remboursement par l’Assurance maladie (négociée entre le CEPS et les laboratoires).
Article 42 (LFSS pour 2020)
L’objectif de cette mesure est de protéger les établissements de santé contre une augmentation trop importante du prix de certains médicaments « intra-GHS ». La mesure permet aux ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale de fixer des prix maximaux de vente de certains produits « intra-GHS » aux établissements de santé, dans des cas particuliers (ex. pour des raisons de santé publique, de maîtrise des coûts, en cas d’augmentation injustifiée des prix ou lorsque le coût unitaire d’un produit est élevé). Cette disposition peut être utilisée ponctuellement, mais n’a pas vocation à s’appliquer à tous les médicaments hospitaliers.
Génériques
Article 66 (LFSS pour 2019)
Cet article de la LFSS pour 2019 vise à favoriser le recours aux médicaments génériques et biosimilaires, en plus des mesures déjà mises en place comme le dispositif incitatif de « tiers payant contre générique ». En cas de refus de substitution par le patient, le remboursement à l’assuré du médicament princeps se fera désormais sur la base du prix du médicament générique (sauf en cas d'absence de substitution justifiée par le médecin sur la base des critères définis par l’arrêté du 12 novembre 2019 en application de l'article L. 5125-23 du CSP et par le pharmacien par l'arrêté du 30 janvier 2020 modifié le précédant arrêté). La différence entre le prix du médicament princeps et celui du générique constitue donc un reste à charge pour le patient.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le module sur les Médicaments génériques, biosimilaires et hybrides
Association
Article 65 (LFSS pour 2019)
La mesure vise à permettre au CEPS de fixer les niveaux de remises pour les médicaments utilisés en association :
- pour les produits d’immunothérapie utilisés en association, notamment lorsqu’ils sont exploités par des laboratoires différents, dans le cas où une solution conventionnelle avec le CEPS n’est pas trouvée, des remises fixées de manière unilatérale pourront être appliquées, et ce, dans le respect de l’accord-cadre ;
- pour les autres médicaments utilisés en association, le remboursement des spécialités peut être soumis au versement obligatoire d’une remise.
Ces remises sont fixées par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité et le CEPS.
Article 59 (LFSS pour 2022)
Entre 2014 et 2019, l’analyse des indications relatives aux produits de santé de la liste en sus montre que, dans près de 20 % des cas, elles sont associées à des utilisations qui ne sont pas présentes dans le référentiel administratif et que ces produits sont prescrits en dehors d’une indication prévue par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou hors indications thérapeutiques remboursables.
Ces utilisations ont un impact significatif sur le budget de l’Assurance maladie alors même qu’elles ne devraient, en théorie, pas être prises en charge. Parmi ces utilisations, les associations de traitements – à savoir au moins deux médicaments qui ne sont pas nécessairement commercialisés par le même laboratoire pharmaceutique – constituent une catégorie particulière : les AMM miroirs.

Le concept d'AMM miroirs
Seul un des deux laboratoires réalise des essais cliniques et dépose une demande d’AMM, puis une demande d’inscription dans l’indication considérée ce qui donne lieu à une négociation tarifaire, tandis que l’autre laboratoire n’en fait rien, son produit étant généralement déjà inscrit pour d’autres indications. On parle alors d’« AMM miroir ». L’association des deux médicaments est en pratique prise en charge, alors qu’un des deux médicaments est hors référentiel et que son prix n’a pas été négocié au regard de cette nouvelle utilisation, puisque ce dernier ne bénéficie pas de l’AMM et que l’exploitant n’a donc fait aucune demande d’inscription.
Cette prise en charge a, en pratique, été tolérée dans la mesure où l’encadrement sanitaire reste garanti et qu’il s’agit de produits onéreux qui pèseraient autrement sur le budget des établissements. Ces situations devenant de plus en plus nombreuses avec un impact financier conséquent, le législateur a souhaité les régulariser en officialisant la prise en charge de ces situations et en fixant un cadre tarifaire.
La mesure régularise donc la prise en charge et, en contrepartie, met en place un système de remises obligatoires au regard du niveau d’utilisation hors référentiel pour un produit de santé donné qui « dispose » d’une « AMM miroir ». Ces remises se feront donc, comme dans les cadres de prescription compassionnels (CPC), sur la base du chiffre d’affaires annuel (CA) pour le produit de santé concerné pour la part facturée hors référentiel, dont les taux seront fixés par un arrêté des ministres de la santé et de la Sécurité sociale en attente de publication.
Empreinte industrielle
Article 65 (LFSS pour 2022)
Selon les articles L. 162-16-4 (I) et L. 165-2 (I) du CSS, la fixation du prix « tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Ces critères « principaux » de fixation de prix, légalement précisés, font donc toujours l’objet d’un examen par l’administration sans être toutefois limitatifs, s’agissant seulement de critères « principaux ».
Dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, le Gouvernement souhaite renforcer la prise en compte de l’empreinte industrielle dans la fixation des prix des produits de santé, de façon à inciter à l’augmentation des capacités de production en vue de l’approvisionnement du marché national, en inscrivant expressément ce critère de prix.
Cette mesure propose d’inscrire un nouveau critère de fixation des prix des produits de santé. L’ajout de ce nouveau critère ne revient pas sur le système de tarification actuel des produits de santé, fondé principalement sur la valeur thérapeutique du produit, mais affiche ainsi expressément la prise en compte d’une implantation industrielle garantissant une production à destination du territoire national en complément des critères principaux. Les conditions d’application devront faire l’objet d’un cadrage.
Acteurs mentionnés dans cet article
NO-FR-2400124-NP-Juin 2024