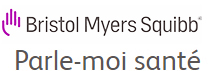Rétrospective des dernières lois de financement de la sécurité sociale (2017-2022)
Médicaments génériques, biosimilaires et hybrides
Lorsque qu’un médicament original tombe dans le domaine public, tout autre laboratoire pharmaceutique peut à son tour produire le médicament sous une forme qui va copier le médicament original ou de référence. Ainsi, en parallèle des princeps, différentes catégories de médicaments sont disponibles : génériques, biosimilaires et hybrides. Ces médicaments représentent un intérêt financier et un intérêt de santé publique. Les lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS) successives ont introduit des articles visant à promouvoir leur recours.
Le médicament est caractérisé par un cycle de vie – de sa R&D à sa commercialisation. Au début de ce cycle de vie, le médicament est protégé par un brevet et les données acquises en vue de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) sont également protégées pour une durée limitée. Ces formes de protections garantissent une exclusivité commerciale qui doit permettre le retour sur investissement pour le laboratoire qui a mis au point le médicament. A l’issue de cette période d’exclusivité, c’est-à-dire quand le médicament tombe dans le domaine public, tout autre laboratoire pharmaceutique peut à son tour produire le médicament sous une forme qui va copier le médicament original ou de référence. On parle alors de génériques, d’hybrides ou de biosimilaires.
Définitions
Médicament générique (Article L. 5121-1 du code de la santé publique)
« une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées »
Médicament biosimilaire (Article L. 5121-1-15 du code de la santé publique)
« tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence, mais qui ne remplit pas les conditions (…) pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire »
Médicament hybride (Article L. 5121-1 du code de la santé publique)
« spécialité qui ne répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité »
Rappels
Médicaments génériques
Un médicament générique est fabriqué à partir de la même molécule qu’un médicament déjà autorisé, dit médicament de référence, et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Il a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et il a démontré sa bioéquivalence (il se comporte de la même façon dans l’organisme). Il a donc la même efficacité thérapeutique que la spécialité de référence, alors que son coût est moindre.
Cadre réglementaire
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) est chargée de l’évaluation, du contrôle en laboratoire et de l’inspection des spécialités génériques. Une spécialité générique, comme toute spécialité pharmaceutique, doit faire l’objet, avant sa commercialisation, d’une AMM. L’AMM est délivrée par le Directeur général de l’ANSM, dans le cadre d’une procédure nationale, d’une procédure européenne de reconnaissance mutuelle ou d’une procédure décentralisée. Les décisions d’inscription au répertoire des groupes génériques (ou portant modification du répertoire des groupes génériques) font l’objet d’une publication officielle sur le site internet de l’ANSM. La liste des médicaments génériques autorisés est disponible dans ce répertoire présent sur le site internet de l’ANSM. Les spécialités figurant dans le répertoire sont classées par groupes. Chaque groupe comporte une spécialité de référence et ses génériques.
Prescription & substitution
Présents dans la plupart des domaines thérapeutiques, les médicaments génériques font aujourd’hui partie de la pharmacopée quotidienne. En prescrivant en dénomination commune internationale (DCI), le médecin fait le choix de la molécule et donc du mécanisme d’action correspondant aux besoins médicaux et à la situation du patient, tout en facilitant la substitution. A ce titre, depuis janvier 2015, les médecins ont l’obligation de prescrire en DCI. En prescrivant en DCI, le médecin permet au pharmacien de choisir, en toute sécurité, un médicament générique qui possède le même principe actif au même dosage. En effet, depuis 1999, les pharmaciens sont autorisés à substituer un médicament générique à celui prescrit, à condition que ce médicament fasse partie du même groupe de médicaments génériques et que le médecin n’ait pas exclu cette possibilité par l’ajout de la mention manuscrite « non substituable » sur l’ordonnance. Le pharmacien doit alors indiquer sur l’ordonnance le nom du médicament qu’il a substitué pour limiter le risque de confusion par le patient.
Incitations au recours aux génériques
Incitation à la prescription
Favoriser les prescriptions dans le répertoire des génériques est une stratégie nationale dont le taux cible est défini par arrêté ministériel chaque année. La promotion de la prescription des médicaments inscrits dans le répertoire des génériques sur les ordonnances de sortie (que le patient reçoive le générique ou le princeps) est notamment intégrée dans le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES).
Incitation à la substitution
Les pharmaciens sont encouragés à substituer les médicaments d’origine par des médicaments génériques et des objectifs sont fixés depuis 2006, dans le cadre de la convention nationale entre l’Assurance maladie et les pharmaciens. L’objectif de taux de substitution fixé par les pouvoirs publics est aujourd’hui de 90 %. En 2018, le taux moyen de substitution était de 88,4 %. Par ailleurs, depuis 2007, le tiers payant est réservé aux patients qui acceptent la dispensation de médicament générique, lorsqu’il en existe, pour le médicament qui leur est prescrit. En cas de refus, ces personnes sont dans l’obligation d’avancer les frais et de remplir une feuille de soins afin d’être remboursés. La prise en charge du médicament par l’Assurance maladie n’est pas remise en cause mais simplement retardée.
Médicaments biosimilaires
À la différence des génériques qui doivent démontrer leur bioéquivalence vis-à-vis du princeps, les biosimilaires étant des produits issus du vivant, ils ne peuvent démontrer de bioéquivalence. Ils doivent démontrer leur similarité au médicament biologique de référence par une démonstration d’équivalence clinique.
Cadre réglementaire
Un cadre réglementaire spécifique aux médicaments biosimilaires a été établi en Europe dès 2005. Dans les pays de l’Union européenne (UE), les demandes d'AMM des médicaments biosimilaires sont soumises à une procédure d'examen centralisée par l'Agence Européenne du Médicament (European Medicines Agency, EMA). Cette dernière a émis des recommandations spécifiques aux médicaments biosimilaires, précisant les prérequis pour l'obtention d'une AMM. Un exercice de comparabilité incluant des essais précliniques et des essais cliniques de phase I et de phase III est nécessaire. Le rigoureux procédé d'évaluation mis en place permet de garantir que le médicament biosimilaire ne présente pas de différences significatives avec le biomédicament de référence en termes de qualité, d'efficacité et de sécurité.
La liste des biomédicaments et de leurs biosimilaires est consultable sur le site internet de l’ANSM.
A la date du 9 juin 2022, seules 16 substances actives / DCI sont inscrites sur la liste de référence des groupes biologiques similaires parmi lesquelles :
4 anti-TNF (adalimumab, étanercept, infliximab et rituximab), 2 antinéoplasiques (bevacizumab et trastuzumab), 3 antidiabétiques (insuline asparte, insuline glargine et insuline lispro), 2 facteurs de croissance hématopoiétiques (filgastrim et pegfilgastrim), 1 anticoagulant (enoxaparine), 1 EPO (epoietine), 1 hormone de croissance (somatropine).
Interchangeabilité & substitution
- Interchangeabilité : l'échange relève d'un acte de prescription réalisé sous la responsabilité du médecin
- Substitution : l'échange relève d'un acte de délivrance réalisé par un pharmacien
Contrairement à l'AMM, qui peut être obtenue à l'échelle européenne, l’EMA laisse à chaque État membre le soin de définir ses propres règles en matières d'interchangeabilité et de substitution. En France, l’ANSM avait initialement émis la recommandation de ne pas remplacer un biomédicament par un autre en cours de traitement. L'évolution des connaissances et les données d'efficacité et de sécurité rassurantes au sein de l'UE l'ont toutefois amenée à réviser sa position sur l'interchangeabilité des médicaments biosimilaires. Ainsi, dans un rapport publié en mai 2016, l'agence sanitaire française indique qu'une interchangeabilité (acte médical) en cours de traitement est envisageable sous trois conditions :
- L'information et l'obtention de l'accord du patient ;
- La mise en place d'une surveillance clinique appropriée ;
- L'assurance de la traçabilité des produits concernés.
Incitations au recours aux biosimilaires
Le développement des biosimilaires renferme deux intérêts majeurs :
- Un intérêt financier : garantir l’efficience des dépenses d’Assurance maladie en dégageant des marges de manœuvre financières ;
- Un intérêt de santé publique : augmenter le nombre de médicaments biologiques disponibles et limiter les tensions d’approvisionnement.
Ainsi, la Stratégie nationale de santé pour 2018-2022 a fixé comme objectif de promouvoir le bon usage des médicaments et le développement généralisé des génériques et biosimilaires, avec une cible d’atteindre 80% de pénétration des biosimilaires sur leur marché de référence d’ici 2022.
Incitations au recours aux biosimilaires
Incitation à la prescription
A l'hôpital
- La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) a lancé en 2018 une expérimentation nationale pour l'incitation à la prescription hospitalière de biosimilaires délivrés en ville dans le cadre du CAQES. Le but étant de relancer une dynamique pour consolider les taux d’initiation et travailler sur les taux de recours en lien avec les acteurs de ville. Cette expérimentation concerne trois molécules : adalimumab, etanercept, insuline glargine. Les modalités et les valorisations sont définies dans l’arrêté du 12 février 2019. Les établissements concernés par cette expérimentation sont définis dans l’arrêté du 2 octobre 2018.
- Un arrêté du 30 septembre 2021 a introduit une expérimentation sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) pour tous les établissements participant à l’expérimentation (publics, privés, maximum 40 établissements) afin d’augmenter de 15 points du taux de prescription des spécialités biologiques (etanercept, adalimumab, insuline glargine), dans les établissements participant à l’expérimentation par rapport à des établissements comparables (hors CAQES).
En ville
- L’avenant n°9 à la convention médicale de 2016 (article 6) a instauré un dispositif d’intéressement facultatif, reposant sur la prescription de six médicaments biosimilaires (étanercept, adalimumab, follitropine alpha, énoxaparine, tériparatide et insuline asparte). Ce dispositif permet tout simplement d’intéresser financièrement le médecin à la prescription, en initiation ou en cours de traitement, d’un médicament biosimilaire à la place du médicament biologique de référence, en accord avec le patient. Il est effectif pour les prescriptions réalisées à partir du 1er janvier 2022, l’intéressement sera versé dès 2023 au titre des prescriptions réalisées en 2022. A ce stade, il n’est donc pas possible de faire un état à date quant à l’efficacité de cette mesure. La liste des molécules visées est susceptible d’évoluer dans le temps.
Incitation à la substitution
En ville
L’article 47 de la LFSS pour 2014 a ouvert la possibilité, pour le pharmacien, de substituer un médicament biosimilaire à un médicament biologique de référence, à la condition de respecter trois conditions principales :
- La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même biosimilaire ;
- Le médecin prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution ;
- Lorsqu’il délivre par substitution un biosimilaire, le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.
Ce mécanisme n’a jamais été mis en œuvre faute de texte d’application. Il a été abrogé par la LFSS pour 2020 (article 42). Néanmoins, l’article 64 de la LFSS pour 2022 ouvre la possibilité de fixer les groupes biologiques au sein desquels le pharmacien d’officine pourra substituer, ainsi que les conditions et modalités dans lesquelles cette substitution devra s’opérer.
Médicaments hybrides
Une spécialité hybride d’une spécialité de référence ne répond pas à la définition d’une spécialité générique. Elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité.
Cadre réglementaire
La procédure d'obtention d'une AMM pour les spécialités hybrides est définie par la Directive européenne 2011/83/EC. Selon le cas, le dossier d'AMM d'un médicament hybride doit comporter des données démontrant la qualité du médicament, des éléments permettant de justifier les différences présentées par rapport à la spécialité de référence, ou encore des études de biodisponibilité spécifiques. En résumé, l’AMM de la spécialité hybride repose pour partie sur les résultats d'essais cliniques du médicament de référence, et pour partie sur de nouvelles données (à la différence de l'AMM d'un générique qui ne repose que sur la démonstration de la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence).
Sur le modèle du répertoire des génériques et de la liste de référence des groupes biologiques similaires, le registre des groupes hybrides est confié à l'ANSM.
Incitations au recours aux hybrides
Un premier arrêté fixant la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits au registre des groupes hybrides a été publié au Journal officiel du 14 avril 2022 :
- Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires - Adrénergiques en inhalation (classification ATC : R03A)
- Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires - Autres médicaments en inhalation pour les maladies obstructives des voies respiratoires (classification ATC : R03B)
Cependant, la substitution au sein des groupes hybrides par le pharmacien d'officine telle que prévue dans le code de santé publique (CSP), notamment les situations médicales pouvant donner lieu à cette substitution, reste suspendue à la parution d'un arrêté ministériel.
Vue d’ensemble des articles au cours des 5 dernières années

Focus sur les articles d'intérêt
Génériques
Article 66 (LFSS pour 2019)
L’adoption de la LFSS 2019 poursuit l’objectif visant à favoriser l’utilisation de spécialités génériques et induire ainsi une diminution des dépenses publiques. En effet, le rapport « Panorama de la santé 2021: Les indicateurs de l'OCDE » mettait en lumière la réticence des Français à se voir administrer des spécialités génériques. Seules 30% des spécialités délivrées en France étaient des spécialités génériques, alors que ce taux atteignait 86% aux États-Unis et 52% en moyenne dans les pays de l’OCDE. C’est pour répondre à cette difficulté qu’a été adopté l’article 66 de la LFSS 2019, qui restreint les conditions dans lesquelles le médecin peut s’opposer à la substitution.
Jusqu’à l’adoption de la LFSS pour 2019, le prescripteur pouvait imposer la délivrance d’une spécialité princeps en apposant manuscritement la mention « non-substituable ». Cette mention devait avoir pour fondement « des raisons particulières tenant au patient » (article L. 5124-26 du CSP, dans sa version antérieure), sans que ces raisons n’aient pour autant à être indiquées par le prescripteur. Cette évolution législative trouve par ailleurs son origine dans l’augmentation de l’apposition sur les ordonnances de la mention « non substituable » (de 1,8% en 2013 à 8,3% en 2016) et par conséquent le constat de l’augmentation des dépenses publiques (évaluées à 104 millions d’euros par an).
Le dispositif de l’article 66 prévoit que la substitution par le pharmacien pourra s’exercer « à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance » (article L. 5123-23, II° du CSP, modifié par L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018). Par conséquent, la seule mention « non substituable » est à présent insuffisante et doit être complétée par une explication quant à la situation médicale justifiant l’exclusion de la délivrance du générique. Aussi, le nouveau dispositif impose au prescripteur de faire connaître les raisons de son choix du princeps au détriment du générique.
Article 42 (LFSS pour 2020)
Médicament à marge thérapeutique étroite
Les médicaments à marge thérapeutique étroite sont des médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces. De ce fait, de faibles variations de dose ou de concentration peuvent entraîner une modification du rapport bénéfices/risques.
Dans le cas des spécialités à marge thérapeutique étroite pour lesquelles tout changement de traitement doit être réalisé avec précaution, il existe des recommandations d’encadrement de la substitution de l’ANSM.
Les médicaments à marge thérapeutique étroite sont des médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces. De ce fait, de faibles variations de dose ou de concentration peuvent entraîner une modification du rapport bénéfices/risques.
Il est donc d’autant plus important pour les prescripteurs de penser aux médicaments génériques lors de l’initiation du traitement. L’article 42 permet tout d’abord au pharmacien de délivrer un médicament princeps en l’absence de la mention « non substituable », pour certains médicaments à marge thérapeutique étroite dans des situations particulières précisées par arrêté.
Il reporte en outre au plus tard au 1er janvier 2022 l’application de la limitation de la base de remboursement en cas de refus de la substitution à deux ans après la publication « du prix de la première spécialité générique du groupe ». La date définitive d’application est fixée par arrêté.
Biosimilaires
Article 66 (LFSS pour 2019)
L’article 66 de la LFSS pour 2019 avait vocation à inciter les établissements de santé à l’achat de biosimilaires. Il s’agissait de faciliter l’achat de médicaments biosimilaires, en leur permettant de prendre en compte l’efficience des dépenses pour le système de santé dans leurs appels d’offres.
Article 42 (LFSS pour 2020)
L’article 42 signait un rétropédalage dans l’utilisation des biosimilaires. En effet, il a abrogé les précédents articles de LFSS, notamment l’article 47 de la LFSS pour 2014. Cette décision était notamment motivée par l’impossibilité « pour des raisons de sécurité et de traçabilité, de modifier la prescription initiale en remplaçant une spécialité par une autre », pointée du doigt par l’ANSM dans son rapport de 2016 « Etat des lieux des biosimilaires ». Dans l’étude d’impact de la LFSS pour 2020, le gouvernement indiquait alors s’appuyer sur d’autres leviers pour favoriser le développement des biosimilaires, notamment « en informant l’ensemble des parties prenantes de l’intérêt d’un traitement par biosimilaire, en favorisant l’interchangeabilité par le prescripteur, et en mettant en place de nouveaux schémas expérimentaux d’incitation à travers l’article 51 de la LFSS pour 2018 ».
Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, avait confirmé le soutien du Gouvernement quant à l’usage des biosimilaires et leur développement, mais avait jugé souhaitable de ne pas « le faire à n’importe quel prix, car les biosimilaires ne sont pas des génériques ». Elle s’était engagée à réétudier le sujet et à travailler avec les parties prenantes durant l’année 2021. L’objectif, en termes de méthodologie, était de procéder par étape et d’étudier au cas par cas, en concertation, si un groupe biosimilaire pouvait relever d’une substitution à l’officine.
Article 64 (LFSS pour 2022)
L’objectif de l’article 64 de la LFSS 2022 n’est pas de rétablir en l’état la disposition abrogée de la LFSS pour 2014. Comme le précise l’étude d’impact, « il s’agit de compléter les leviers existant pour améliorer le recours aux médicaments biosimilaires en ville, en construisant un dispositif autour du pharmacien, en relation avec le prescripteur et le patient ». Le Gouvernement rappelle, dans cette même étude d’impact, que les médicaments biosimilaires représentent « un gisement conséquence d’économies annuelles potentielles » et ce d’autant plus que « les échéances de brevet des années à venir permettent d’envisager une augmentation importante du panier de soins biosimilarisés à hauteur de 1,3 milliard d’euros à l’horizon 2025 ».
L’article 64 ouvre ainsi la possibilité de fixer les groupes biologiques au sein desquels le pharmacien d’officine pourra substituer, ainsi que les conditions et modalités dans lesquelles cette substitution devra s’opérer. Contrairement à la disposition de 2014, cette substitution ne sera pas légalement limitée à l’initiation de traitement mais pourra l’être au cas par cas en fonction des recommandations de l’ANSM. Deux textes d’application viennent préciser la mesure :
- Un arrêté ministériel définissant les conditions de substitution et d’information du prescripteur ;
- Un arrêté ministériel publié après avis de l’ANSM pour fixer la liste des produits (Pegfilgastrim et Filgastrim - arrêté du 12 avril 2022).
Le cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé a en parallèle, sollicité l’ANSM pour une actualisation de sa doctrine sur la substitution de médicaments biosimilaires à l’officine par les pharmaciens. L’agence a rendu son rapport en février 2022 « Etat des lieux sur les médicaments biosimilaires ».

Des arguments en faveur de la substitution biosimilaire
Une littérature qui pousse pour un développement des biosimilaires
La Cour des comptes, dans son rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale de septembre 2017, estimait qu’un recours plus large aux médicaments biosimilaires permettrait près de 680 millions d’euros chaque année. Les magistrats qualifiaient même les biosimilaires de « gisement d’économies à exploiter ».
En 2021, c’est la Caisse nationale d’Assurance maladie qui, dans son rapport Charges & Produits, proposait de réintroduire la substitution biosimilaire à l’officine, en initiation de traitement, hors traitements chroniques, « pour tenir compte des objections et des réticences formulées sur le sujet et pour faciliter son acceptation par les patients ».
Elle estimait que la mesure pourrait générer 10 millions d’euros d’économies au titre de la substitution par les pharmaciens « dans le cas d’une initiation avec des médicaments biosimilaires plus importante pour les classes de gonadotrophines et des héparines fractionnées permettant d’atteindre progressivement un taux de pénétration de 80% des médicaments biosimilaires ». Elle suggérait en outre de renvoyer à une décision de l’ANSM le soin de fixer la liste des groupes biologiques similaires pour lesquels cette substitution serait autorisée.
Des pharmaciens d’officine et hospitalier en faveur d’un droit de substitution
Dans un communiqué de février 2020, les syndicats d’officinaux (FSPF et USPO) rappelaient le rôle primordial des pharmaciens d’officine pour accroître la pénétration des biosimilaires en ville, demandant aux pouvoirs publics de leur faire confiance pour la dispensation et la substitution de tous les médicaments.
En novembre 2020, l’Académie nationale de pharmacie soutenait par la voie d’un communiqué la substitution par les pharmaciens d’officine, tout en définissant ses conditions cadres. Elle estimait ainsi qu’« il n’existe pas d’arguments scientifiques solides pour contester le droit de substitution des biosimilaires par le pharmacien d’officine et le pharmacien hospitalier pour certaines classes de médicaments biologiques ».
Hybrides
Article 66 (LFSS pour 2019)
L’article 66 de la LFSS pour 2019 introduit une nouvelle catégorie de médicaments dits « hybrides », définis par le CSP, qui pourront faire l’objet d’une substitution par le pharmacien. En conséquence, elle introduit également un registre des médicaments hybrides, équivalent du répertoire des médicaments génériques...
Acteurs mentionnés dans cet article
NO-FR-2400124-NP-Juin 2024