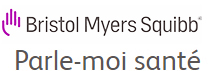Rétrospective des dernières lois de financement de la sécurité sociale (2017-2022)
Dispositif « article 51 » : Expérimentations organisationnelles et financements innovants
Les expérimentations de nouvelles organisations en santé contribuant à l’amélioration de la prise en charge des patients permettent de tester de nombreuses innovations pour mieux soigner. L’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a introduit un cadre spécifique permettant à tous les acteurs de l’écosystème de la santé de proposer des projets d’innovations organisationnelles reposant sur des modes de financement inédits. Depuis 2018, le « dispositif article 51 » a connu un réel succès et un grand nombre de projets ont pu être mis en œuvre.
Introduction
Rappel sur les modalités de financement préexistantes
Le système de santé français s’appuie sur des structures multiples : sanitaires (pour la prise en charge hospitalière), ambulatoires (pour les soins dits « de ville ») et médico-sociales (pour des populations spécifiques telles que les personnes âgées ou souffrants de handicap). Chaque structure possédant sa propre modalité de financement, ce fonctionnement segmenté a cependant montré certaines limites, alors même que les parcours de santé ont vocation à permettre une prise en charge globale des patients, quelle que soit la structure concernée.
Limites du système de financement segmenté
Plusieurs aspects de notre système de santé ont amené à questionner une évolution de son organisation :
- Tout d’abord, la transition épidémiologique se traduit par un vieillissement de la population et par une augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques. Ces patients ont besoin d’une prise en charge globale pouvant faire appel à tous les acteurs de la santé ;
- Parallèlement, l’offre de soins est répartie entre les secteurs de la ville, l’hôpital et le médico-social, avec des modes de financement dédiés à chaque secteur, ce qui représente un frein au développement de modèles de prises en charge multidisciplinaires, coordonnés et intersectoriels ;
- Enfin, les dépenses de santé s’inscrivant dans une enveloppe budgétaire définie, améliorer les parcours de santé et les résultats de santé qui importent aux patients implique l’utilisation optimisée des ressources disponibles.
Face à ces constats, une modernisation de notre système de santé est apparue nécessaire pour l’ensemble des acteurs de santé afin de repenser l’organisation et le financement des soins de manière à favoriser le service rendu au patient.
Les expérimentations en santé reposant sur des financements innovants
Introduction du cadre juridique du dispositif de l’article 51
La LFSS pour 2018 a introduit, en son article 51, un dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer la prise en charge globale des patients.
Cette mesure introduit un cadre juridique spécifique permettant la mise en œuvre de projets innovants pour améliorer les parcours de santé, sous la forme d’expérimentations pour une durée maximale de 5 ans, qui peuvent être portées par des acteurs locaux ou nationaux. Il s’agit là d’un nouveau levier pour tester de nouvelles approches puisque ce dispositif permet de déroger à de nombreuses règles de financement de droit commun, applicables en ville comme en établissement hospitalier ou médico-social.
Cet article introduit également la création d’un Comité Technique de l’Innovation en Santé (CTIS), chargé de l’examen des projets d’expérimentation, et du Conseil Stratégique de l’Innovation en Santé (CSIS), chargé quant à lui de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé et de suivre les expérimentations mises en place pour émettre un avis en vue de leur éventuelle généralisation.
Evaluation des propositions d’expérimentations
Les propositions d’expérimentations peuvent être à l’initiative de tous les acteurs du système de santé (comme les professionnels de santé, les établissements ou les associations de patients par exemple) ou bien répondre à des appels à projets, qu’ils soient régionaux ou nationaux. Ces projets peuvent avoir une portée régionale (le projet devra alors être soumis à l’Agence Régionale de Santé [ARS]), interrégionale ou encore nationale (ils devront dans ce cas être soumis au Rapporteur général du dispositif, désigné par les ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale).
Chaque expérimentation fait tout d’abord l’objet d’une évaluation par le CTIS, placé auprès des ministres de la santé et de la Sécurité sociale, et dont la composition est détaillée à l’article R.162-50-2 du code de la Sécurité sociale. Il émet un avis sur les projets d’expérimentation, leur financement et leur évaluation, et doit également saisir pour avis la Haute Autorité de Santé (HAS) lorsque le projet d’expérimentation comporte des dérogations relatives à l’organisation ou la dispensation de soins. Il dispose de 3 mois pour donner son avis (4 mois quand un avis de la HAS est requis).

Les expérimentations autorisées et mises en œuvre doivent être évaluées tout au long de leur déploiement par un évaluateur externe, désigné par la Caisse nationale d’Assurance maladie, qui devra rédiger périodiquement des rapports d’évaluation de l’expérimentation. Cette évaluation est primordiale pour apprécier l’efficacité du projet et la pertinence de sa pérennisation, et se base notamment sur 3 grands critères. On peut citer les exemples suivants :
- La faisabilité / opérabilité évalue entre autres les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre, ce dans un délai et à un coût raisonnable ;
- L’efficacité / efficience prend notamment en compte l’amélioration de l’expérience des patients/usagers (via l’utilisation de Patients Reported Outcome Measures [PROMs] et de Patients Reported Experience Measures [PREMs]) des professionnels, des aidants, etc. ;
- La reproductibilité étudie par exemple la soutenabilité pour le système de l’impact budgétaire en cas de « généralisation » ou « de passage » à une échelle plus importante.
Les rapports d’évaluation ainsi que les rapports d’étapes du projet sont transmis au CTIS et au CSIS, qui rendront un avis sur l’opportunité et les modalités de la généralisation des dispositifs en expérimentation.
Financement des expérimentations
La mise en œuvre des expérimentations est financée, totalement ou en partie, par le Fonds pour l’Innovation du Système de Santé (FISS) créé par l’article 51 de la LFSS pour 2018. Ce fonds pour l’innovation est alimenté par des dotations annuelles des branches maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de l’Assurance maladie (définies par arrêté), et sa gestion et son pilotage sont assurés notamment par le conseil stratégique, le comité technique, les ARS ainsi que par l’Assurance maladie.
Ce financement dérogatoire du FISS peut compléter un financement de droit commun ou du Fonds d’Intervention Régional (FIR) qui permet de financer des actions et expérimentations validées par les ARS.
Ce dispositif d’expérimentations, aussi appelé « dispositif 51 », constitue donc une grande avancée pour le système de santé, en favorisant l’émergence de structures et de pratiques alternatives faisant appel à des modes de financement et d’organisation inédits, permettant de décloisonner le système de santé français et d’inciter à la coopération entre les acteurs.
L’élargissement du dispositif pour permettre sa pleine application
La mise en place du dispositif d’expérimentation pour l’innovation du système de santé, prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018, a permis à de nombreux porteurs de projets de manifester leur intérêt pour ce dispositif et de s’engager dans des expérimentations pour transformer leurs organisations. Les projets proposés, qu’ils soient nationaux ou locaux, visaient cependant essentiellement à promouvoir des modes de financement innovants. Il est donc rapidement apparu nécessaire d’amplifier la portée des expérimentations pour permettre aux acteurs qui le souhaitaient de s’engager plus franchement dans l’innovation organisationnelle, notamment en ce qui concerne les établissements de santé.
Il a donc été décidé de simplifier les démarches pour les porteurs de projet et d’élargir la portée de l’article 51 pour accélérer la transformation des organisations, améliorer l’accès au soins et lever les freins éventuels à la mise en œuvre de certaines expérimentations. À titre d’exemple, une mesure consistait à mieux articuler le dispositif 51 avec le dispositif des protocoles de coopération (créé par l’article 51 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires [HPST]), pour permettre une meilleure organisation du transfert d’actes ou d’activités de soins entre professionnels de santé. Les projets d’expérimentation comportant un protocole de coopération sont donc désormais, comme les autres projets, examinés par le comité technique, mais celui-ci doit saisir pour avis la HAS, qui aura un délai de 6 mois pour se prononcer.
La durée de prise en charge de ces expérimentations a également été prolongée : l’article 80 de la LFSS pour 2022 a introduit une mesure permettant aux expérimentations dont la généralisation a fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique et du comité technique de continuer de bénéficier d’une prise en charge transitoire au delà de leur échéance, et ce pour une durée maximale de 18 mois, dans l’attente d’une prise en charge par les dispositifs de droit commun.
Bilan 3 ans après la mise en place du dispositif 51

En ce qui concerne les porteurs de projets, ils sont majoritairement constitués des établissements de santé (35%), de groupements d’acteurs comme des fédérations syndicales (20%) et des acteurs de ville (14%). Cela est cohérent avec les principaux secteurs de déploiement des projets déposés depuis 2018, relatifs le plus souvent à l’ambulatoire ou au secteur mixte ville/hôpital. Le rapport au Parlement montre également une similarité des thématiques parmi les projets autorisés : on retrouve notamment les prises en charge du surpoids et de l’obésité, des situations cliniques liées au vieillissement, la santé bucco-dentaire et le cancer.
Le rapport au Parlement nous montre également que les engagements financiers fournis dans le cadre de ce dispositif sont croissants, avec un budget FISS pluriannuel de plus de 460 millions d’euro fin 2021, et de plus de 15 millions d’euros pour le fonds d’intervention régional. Compte tenu de la variété des expérimentations autorisées en termes de périmètre et de champ d’application, avec des coûts allant de 70 000 euros à plus de 20 millions d’euros, il apparaît difficile d’en calculer un montant moyen.
Vue d’ensemble des articles au cours des 5 dernières années

Focus sur les articles d’intérêt
Article 39 (LFSS pour 2019)
La LFSS 2019 visait à compléter les dispositions introduites par l’article 51 de la LFSS 2018, pour notamment permettre sa pleine application, amplifier sa portée ainsi que lever les freins à la mise en œuvre de certaines expérimentations.
Une des mesures consistait à simplifier les démarches pour les porteurs de projets, en réunissant notamment plusieurs dispositifs mis en place pour favoriser les expérimentations en santé afin de bénéficier d’un « guichet unique » pour proposer des projets.
La loi prévoyait également d’élargir le dispositif 51 pour accélérer la transformation des organisations et améliorer l’accès aux soins, particulièrement dans le cas des établissements de santé. Plusieurs mesures ont alors été introduites : la possibilité d’expérimenter de nouvelles organisations hospitalières dérogeant aux conditions techniques de fonctionnement (sur avis obligatoire de la HAS), la mise en place de conditions d’exercice plus souples et plus attractives pour que les professionnels médicaux expérimentent une activité libérale « hors des murs » de leur établissement de santé (dans une logique de réponse aux enjeux de démographie médicale)…
Cette LFSS pour 2019 est donc venue simplifier et élargir le dispositif 51, et a permis la mise en application de nombreux projets.
Article 80 (LFSS pour 2022)
La LFSS pour 2022 s’inscrit dans la continuité de celle de 2019 qui visait à simplifier et amplifier le dispositif 51. Elle a en effet introduit la création d’une phase transitoire post-expérimentation qui permet sa prise en charge par le FISS dans l’attente de sa généralisation. Cette prise en charge repose néanmoins sur l’obtention d’un avis favorable du comité technique et du conseil stratégique pour l’innovation en santé, et permet à l’expérimentation d’être financée pendant une durée qui ne peut excéder 18 mois.
A noter que, via ses articles 77 et 83, la LFSS pour 2022 généralise trois expérimentations – à savoir les expérimentations « Mission : Retrouve Ton Cap » (MRTC, surpoids et obésité infantiles), « Au Labo Sans Ordo » (ALSO, dépistage VIH) et « Halte soins addictions » (réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogue).
L’article 80 n’expose pas l’avenir des expérimentations 51 dans leur entièreté, puisqu’il ne leur permet d’être prises en charge que pendant 18 mois et n’introduit pas clairement les mesures de prises en charge de droit commun.
La LFSS pour 2023 pourrait clarifier cette transition des expérimentations dans la pratique courante. Le rapport de l’Assurance maladie au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’Assurance maladie au titre de 2023 a notamment émis une proposition (n°21) afin de faciliter le passage à l’échelle des expérimentations innovantes accompagnées dans le cadre de l’article 51 en créant un nouveau cadre de tarification permettant le financement de « forfaits », pouvant être adaptés à chaque dispositif.

Proposition 21 du rapport produits et charge de l’Assurance maladie pour 2023
Afin de préparer le passage dans le droit commun des expérimentations favorablement évaluées dans le cadre de l’article 51, différents travaux peuvent être anticipés pour adapter le cadre général de fonctionnement et de tarification des soins. Les modes de financement dérogatoires expérimentés prennent le plus fréquemment la forme de forfaits pluriprofessionnels à l’épisode de soins. Les évolutions du cadre de droit commun portent sur trois dimensions :
● Développer à partir de la diversité d’expérience de l’article 51 un cadre de tarification des forfaits reposant sur une nomenclature nouvelle adaptée permettant de décrire le maximum de forfaits avec des règles communes. La définition de ce cadre et de sa gouvernance ainsi que son articulation avec les cadres existants devront se faire en associant étroitement les acteurs concernés, en ville comme à l’hôpital.
● Mettre en place les conditions juridiques de techniques du paiement forfaitaire à l’épisode de soins. Cela suppose d’une part de définir et clarifier le rôle de « structures concentratrices de forfaits à l’épisode de soins » et le cadre juridique entourant cette fonction nouvelle, qui doit être restreinte à un nombre limité d’acteurs-types de développer.
Adapter les systèmes d’information et de facturation pour permettre une mise en œuvre rapide et efficace de la diversité de forfaits potentiels, en s’inspirant des solutions logicielles mises en œuvre dans le cadre de l’article 51.
Acteurs mentionnés dans ce module
NO-FR-2400124-NP-Juin 2024