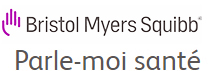Rétrospective des dernières lois de financement de la sécurité sociale (2017-2022)
Efficience et pertinence des prescriptions/soins
Améliorer la pertinence et l’efficience des soins est un enjeu majeur pour notre système de santé, afin notamment d’assurer la soutenabilité des dépenses de santé par l’Assurance Maladie. A travers les différentes Lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS), de nombreux dispositifs visant à favoriser le « juste soin » ont été mis en place, dont la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et la contractualisation des établissements de santé avec l’Assurance Maladie.
La maîtrise médicalisée des dépenses de santé
La thématique de la pertinence et d’efficience des soins s’est imposée dans les priorités de gestion du risque, partagées entre l’État et l’Assurance Maladie – englobant les actions de maîtrise médicalisée de la dépense de santé engagées depuis plus de dix ans par l’Assurance Maladie.
Définition et objectifs
Le rapport « Charges et Produits » de 2017 de l’Assurance Maladie définit la maîtrise médicalisée des dépenses de santé comme la promotion du « juste soins », c’est-à-dire un soin pertinent, efficace, conforme aux recommandations, organisé de la manière la plus efficiente possible, en évitant de gaspiller des ressources sans valeur ajoutée pour la santé. La maîtrise médicalisée s’inscrit dans un objectif de développement de la qualité des soins et d’optimisation du système afin d’assurer la soutenabilité des dépenses par la collectivité.
Fondements et mise en place
La maîtrise médicalisée des dépenses de santé a été initiée avec des outils d’analyse de l’activité des professionnels de santé, perçus comme une approche purement administrative et comptable. Le système des « clés flottantes », créé en 1999, consistait en effet à fixer des objectifs de dépense par profession, les dépassements des volumes des différents actes devant être récupérés par une baisse de leur valeur unitaire. Ce système n’a néanmoins jamais été fonctionnel car il pénalisait de façon indifférenciée l’ensemble des professionnels de santé.
Depuis la loi du 13 août 2004, la maîtrise médicalisé des dépenses de santé repose sur plusieurs dispositifs :
- Le développement de parcours de soins avec comme point d'aiguillage le médecin traitant ;
- Le développement de référentiels médicaux par la Haute Autorité de Santé (HAS) ;
- La définition de thèmes et d’objectifs chiffrés via des conventions professionnelles (ex. médecins généralistes, spécialistes, pharmaciens, etc.). Ces dernières sont complétées et appuyées par la possibilité de sanctions en cas d’inobservation des règles du code de la Sécurité sociale (CSS).
L’Assurance Maladie a également orienté ses actions vers l’accompagnement et le contrôle des professionnels de santé libéraux. Chaque année, elle établit un plan d’actions de maîtrise médicalisée des dépenses de soins de ville, dont le rapport « Charges et Produits » remis au Parlement rend compte. Ces actions de maîtrise médicalisée visent à générer des économies et s’appuient sur trois principaux leviers :
- Les outils conventionnels incitatifs en faveur des bonnes pratiques, permettant d’inciter les professionnels de santé à réaliser ou à prescrire des soins de manière pertinente. Depuis 2012, il s’agit notamment de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) ;
- L’accompagnement des professionnels, via des échanges confraternels et des visites de délégués de l’Assurance Maladie ;
- Le contrôle des volumes de prescription, notamment au travers de la procédure de mise sous accord préalable (MSAP) en cas de volumes de prescriptions nettement supérieurs à la moyenne régionale ou départementale.

Pour en savoir plus : la mise sous accord préalable (MSAP)
Prévue aux articles L. 162-1-15 et R. 148-1 à R. 148-9 du CSS, la mise sous accord préalable consiste à subordonner la prise en charge de prescriptions, prestations, ou actes réalisés par un professionnel de santé, à l’accord préalable du service de contrôle médical compétent de l’Assurance Maladie. La décision de mise sous accord préalable du professionnel de santé a lieu après constatation par l’organisme local d’Assurance Maladie de volumes de prescriptions, d’actes ou de prestations nettement supérieurs à la moyenne. La MSAP sera alors effective pour une durée déterminée, ne pouvant excéder 6 mois, définie par le directeur général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM).
En définitive, depuis l’arrêté du 3 février 2005, avec leur inscription dans la convention médicale et avec un engagement du corps médical « dans un effort collectif visant au bon usage des soins et au respect des règles de la prise en charge collective », les actions de maîtrise médicalisée conduites par l’Assurance Maladie représentent en moyenne 500 millions d’euros par an.
Focus sur le Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES)
Dans le même objectif d’amélioration de l’efficience et de la pertinence des soins, les Contrats d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) ont été créés par l’article 81 de la LFSS pour 2016. Les CAQES visent à mobiliser de manière plus efficiente les outils contractuels d’amélioration de la qualité des soins et de régulation des dépenses. Il s’agit de contrats triparties signés entre :
- Le représentant légal de l’établissement de santé concerné ;
- Le directeur général de l’ARS (ou le délégué départemental) ;
- Le directeur de l’organisme local d’Assurance Maladie.
Ils concernent l’ensemble des établissements sanitaires (établissements de médecine, chirurgie, obstétrique [MCO], centres de soins de suite et de réadaptation (SSR), établissements de santé mentale, unités de soins longue durée), et ce quel que soit leur statut (public ou privé).
Le CAQES de 2018-2021
Le premier CAQES est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il comprenait un volet socle obligatoire, relatif aux produits de santé et conclu pour une durée indéterminée, ainsi que 3 volets additionnels pouvant être proposés aux établissements au regard de leur activité, et conclut pour une durée maximale de 5 ans. Chaque volet du CAQES contenait des indicateurs d’évaluation, pouvant être nationaux (fixés par arrêté) et régionaux (définis par l’ARS, l’Assurance Maladie, ou encore l’Observatoire des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique [OMEDIT]).
Le CAQES de 2022-2026
La LFSS pour 2020 a cependant modifié le CAQES 2018, afin de recentrer le contrat sur un nombre plus limité de priorités.
Le CAQES de 2022 est dorénavant conclu pour une durée maximale de 3 à 5 ans selon les régions. Il comprend :
- Trois volets facultatifs : « produits de santé », « pertinence des pratiques » et « organisation des soins », (le volet « produits de santé » était jusqu’alors obligatoire et à durée indéterminée) ;
- 7 indicateurs nationaux (accompagnés d’un nombre variable d’indicateurs régionaux).
Les autres principales caractéristiques de ce contrat sont :
- Une contractualisation uniquement pour les établissements ciblés ;
- La suppression des sanctions en cas de non atteinte des résultats ;
- La complémentarité avec la rémunération à la qualité ;
- L’adaptation du dispositif d’intéressement financier en fonction des résultats.

Vue d'ensemble des articles au cours des 5 dernières années

Focus sur les articles d'intérêt
Article 57 (LFSS pour 2018)
Cet article de la LFSS pour 2018 visait à inciter davantage les acteurs du champ sanitaire à répondre à des objectifs de qualité, de pertinence et d’efficience des soins, ce qui était déjà amorcé par la création de plusieurs dispositifs comme les CAQES et le dispositif IFAQ (Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité). Concernant les CAQES, il n’existait pas de dispositif d’intéressement des établissements de santé, mais seulement un système de sanctions en cas de manquement aux objectifs, ce qui rendait difficile la fédération des établissements de santé autour des objectifs du CAQES.
La LFSS pour 2018 a donc permis la création d’un dispositif d’intéressement des établissements de santé ayant conclu un CAQES, sous la forme de dotations du Fonds d’Intervention Régional (FIR) pouvant aller jusqu’à 30 % des économies générées en fonction des résultats obtenus pour les indicateurs du contrat. De plus, l’intéressement préexistant – qui ne concernait que les volets additionnels des CAQES – a été étendu au volet obligatoire relatif aux produits de santé.
Article 58 (LFSS pour 2018)
Toujours dans un objectif d’accroître la pertinence et la qualité des soins, l’article 58 de la LFSS pour 2018 a introduit de nombreuses mesures visant à améliorer la pertinence de l’utilisation des produits de santé. Une des mesures était notamment la subordination de la prise en charge par l’Assurance Maladie de certains produits de santé à la présence des renseignements sur les circonstances et indications de la prescription, portés par le professionnel de santé sur l’ordonnance. Cela permet en effet d’encadrer les prescriptions pour mieux vérifier l’adéquation aux recommandations de prise en charge et aux indications thérapeutiques remboursables.
Ces deux articles 57 et 58 de la LFSS pour 2018 ont donc permis de renforcer l’encadrement de l’utilisation des médicaments et plus largement des produits de santé, mais sont centrés plus particulièrement sur leur utilisation à l’hôpital.
Article 64 (LFSS pour 2020)
Cet article modifie le CAQES signé entre les établissements de santé, les ARS et l’Assurance Maladie afin de :
- Recentrer le contrat autour d'un nombre limité de priorités axées sur la pertinence, en renforçant le dispositif d’intéressement des établissements aux économies réalisées pour l’assurance maladie et en les ciblant sur les établissements à plus forts enjeux ;
- Renforcer les leviers des ARS via la possibilité de fixer des volumes cibles attendus pour certains des actes, prestations et prescriptions concernées dans les établissements identifiés.
Article 65 (LFSS pour 2020)
La LFSS pour 2020 vise quant à elle à améliorer la pertinence des prescriptions de médicaments via plusieurs mesures :
- La possibilité d’instaurer une pénalité financière à l’encontre des laboratoires exploitant des médicaments dont le conditionnement ne serait pas adapté à leur utilisation dans la pratique clinique ;
- La mise en place d’outils d’amélioration de la pertinence pour augmenter le recours aux médicaments efficients tels que les médicaments biosimilaires, notamment dans les établissements de santé. Cela permet en effet d’inciter les hôpitaux à l’achat de médicaments efficients, d’initier le traitement des patients par ces produits et ainsi poursuivre leur pénétration en ville ;
- L’élargissement à tout produit de santé remboursable, et à tout moment, de la possibilité de mise en œuvre d’une demande d’accord préalable à la prise en charge par l’Assurance Maladie. En effet, seuls certains actes ou prestations, souvent coûteux ou rares, sont soumis de manière systématique à un accord préalable de l’Assurance Maladie (par exemple les actes de masso-kinésithérapie ou certains transports en ambulance). Cette mesure permet donc d’étendre ce dispositif à tous les produits de santé selon les besoins ;
- La mise en place d’une pénalité financière graduée et dissuasive pour les professionnels de santé ne modifiant pas leurs pratiques d’hyper-prescription. En cas de récidive du professionnel de santé (définie comme une récidive après 2 épisodes de MSAP), il pourra être soumis à une pénalité dont le montant sera fixé proportionnellement aux sommes concernées.
Pour continuer d’améliorer l’efficience et la pertinence des soins, la LFSS pour 2020 a renforcé l’encadrement des prescriptions de produits de santé et des réalisations d’actes médicaux, cette fois via des mesures financières.
Acteurs mentionnés dans ce module
NO-FR-2400124-NP-Juin 2024